
Critique du film Alien : Romulus (Fede Alvarez, 2024)
La saga Alien est un monument du cinéma. De nombreux réalisateurs de renom s’y sont succédés, conférant à l’œuvre globale une richesse appréciable, bien qu’inégale. En 2015, Ridley Scott, le réalisateur du premier opus est choisi par la 20th Century Fox pour mettre en chantier une nouvelle trilogie. Le premier film, Prometheus, fait de bons résultats au box-office, tandis que le second, Alien : Covenant, divise les fans si bien que le troisième film ne verra jamais le jour, la Fox préférant limiter les frais et réévaluer la saga.
Après moults négociations, c’est au réalisateur Fede Alvarez qu’incombe la lourde tâche de réconcilier les fans avec la saga, et de nombreuses spéculations viennent alimenter les attentes des fans : Où inscrire le film dans la continuité, que raconter de nouveau, et enfin, comment surprendre le public avec une créature qui n'a plus de secret ?

Situé entre les deux premiers films de la saga, Alien : Romulus se révèle avare en références aux autres films, ce qui est loin d’être une mauvaise chose. Le film reprend sur le papier le concept le plus élémentaire de la saga, à savoir : Un vaisseau labyrinthique plongé dans l’obscurité, un équipage et un alien. Classique en apparence, cette proposition est toutefois un retour aux sources salutaire, prenant à contrepied les deux derniers films de Ridley Scott, davantage centrés sur les origines de la créature mais dont le résultat plus que décrié par les fans manquait cruellement de cohérence.
Parmi les raisons à l’origine de l’intérêt décroissant du public pour la saga, il convient de relever le manque d’intérêt significatif que suscitaient les protagonistes de Prometheus et Alien Covenant. Outre des comportements stupides indignes de leurs qualifications, leur caractérisation frôlait parfois le néant, se limitant à un simple prénom ou gimmick, les réduisant à de la chair à canon. Contrairement aux slasher movies, la force de la saga Alien repose sur la lutte entre une espèce humaine démunie malgré son essor technologique et un organisme prédateur conditionné pour tuer. Et ce rapport de force ne fonctionne qu’en étant équilibré.
A l’instar de Don’t Breathe, Fede Alvarez propose des protagonistes jeunes et hardis, dont le statut de quasi esclaves de la Weyland Yutani permet à la fois de susciter l’empathie du spectateur, mais aussi de leur conférer un engagement émotionnel nécessaire à leur survie. De plus, le groupe peut compter sur Andy, le traditionnel androïde du groupe, dont les facultés cognitives permettent de comprendre plus rapidement qu’à l’accoutumée les mécanismes propres à l’alien. Ainsi, lorsqu’un des membres du groupe se retrouve parasité par un Face-Hugger, le diagnostic d’Andy permet aux personnages d’ôter le parasite, chose rare dans la saga. Le personnage d’Andy est sans doute la plus grande force du film, car en plus d’empêcher le film de repomper certaines scènes de la saga trop facilement, ses facultés vont générer chez lui un conflit entre son instinct de machine et ses sentiments pour les humains, donnant de la nuance aux actions du groupe.

De l’autre côté, on retrouve le Xenomorphe, dont l’aura et le mystère se sont amoindris au fil des années. Il faut dire qu’après 6 films qui lui sont consacrés, l’apparence du monstre n’est plus un secret, et son fonctionnement est si bien connu qu’il convient désormais de redoubler d’originalité pour ne pas ressasser la même histoire.
Alvarez se révèle brillant en parvenant à exploiter des éléments négligés par la mythologie de la saga, tant du côté de l’alien que de la science-fiction en général. Cela s’illustre par exemple au cours d’une scène où les personnages, acculés face à une horde d’aliens, se servent astucieusement de la gravité artificielle du vaisseau. Une fois ce dernier en apesanteur, ils peuvent alors mitrailler les créatures sans que leur sang acide ne puisse s’attaquer au plancher du vaisseau, ce qui les mènerait à une mort certaine. S’en suit une scène où l’acide est suspendu dans l’air, obligeant les protagonistes à flotter au travers, craignant à tout instant que la gravité ne revienne.
Enfin, le tout est accompagné d’une mise en scène inventive, baignant le spectateur dans une obscurité rougeâtre et dérangeante, à l'image de l'univers cauchemardesque de la créature. La bande son, quant à elle, convoque avec joie les thèmes du premier film. Du moins, c’est lorsqu'Alvarez ne décide pas de taire le moindre son pour nous immerger dans le vide spatial...
...car, au cas où vous l’auriez oublié, dans l’espace, personne ne vous entend crier.


Critique du film The Bikeriders (Jeff Nichols, 2024)
The Bikeriders est un titre assez générique de prime abord, dans la même veine que le récent The Killer de David Fincher. Dans le cas qui nous intéresse, le choix de miser sur la figure délavée du biker américain est-il pertinent en 2024 ? Après visionnage, pourtant, force est de constater qu’on ne pourrait trouver un titre plus adéquat, car c’est derrière cette apparente sobriété que se cache le génie du dernier projet de Jeff Nichols.
L’histoire nous est introduite par un prétexte hautement trivial en apparence. Un jeune homme décide d’écrire un livre sur les Vandals, le plus célèbre gang de motards du Midwest des années 60. Il part pour cela recueillir le témoignage de Kathy Cross, une jeune femme sans histoire qui s’est retrouvée au cœur du groupe par un heureux hasard. À travers son récit, nous découvrons tout un clan et son écosystème, centrés sans surprise autour des motos, que nous apprenons à voir d’un regard nouveau tout au long du film. Tout d’abord constitué d’une dizaine d’individus, le collectif croît en nombre jusqu’à perdre sa raison d’être. Deux figures principales s’en distinguent et méritent que l’on s’y attarde.

Benny, tout d’abord, interprété par Austin Butler et petit-ami de Kathy. Après une simple rencontre dans un bar, celle-ci tombe sous son charme et se retrouve à suivre les Vandals bon gré mal gré, considérée de facto comme une figure importante du groupe. Importante car Benny est tout sauf un membre de second rang. Taciturne mais impulsif, jeune mais ô combien déterminé, il réactualise la figure du traditionnel cowboy américain, solitaire de coutume condamné à l’errance qu’on en vient sans trop savoir pourquoi à idéaliser, tant du point de vue de ses pairs que des spectateurs. Sans surprise, c’est avant tout pour être auprès de lui que Kathy fréquente les Vandals, mais il ne fait pas illusion qu’elle demeurera toujours en compétition avec la seule obsession de Benny : être sur une moto et tout ce que cela implique.
Face à lui, Johnny, interprété par Tom Hardy et fondateur des Vandals, groupe pour lequel il a sacrifié femme et enfants. S’il est l’équivalent d’un parrain de mafia pour ses disciples, la création du groupe vient avant tout d’un besoin de fonder une communauté pour parler de moto toute la journée. Derrière son apparence de gros dur, Johnny est un personnage touchant, profondément attaché à ses membres sans qui il redevient un individu lambda. Si le groupe nous est d’abord présenté par Kathy comme un ramassis de mauviettes (à l’exception de Benny), soucieuses de faire la fête et de boire en excès, un premier coup d’éclat change la donne lorsque Johnny ordonne à ses hommes de mettre le feu à un bar, après que Benny y ait été envoyé à l’hôpital pour avoir refusé d’ôter son blouson. C’est d’ailleurs sur cette scène que le film s’ouvre, comme pour mieux instituer Benny comme pièce centrale dans la métamorphose à venir du groupe. Peu de temps après cet incident, il se distingue à nouveau en sautant à la gorge d’un motard rival pour défendre l’intégrité du groupe et de son chef, rouant son opposant de coups après s’être ôté un épais tesson de verre de la main sans sourciller. Johnny est profondément touché par ce signe de loyauté, et une profonde relation d’amitié s’instaure entre les deux personnages, amitié nourrissant des attentes contradictoires à chacun : Johnny espère de tout cœur que Benny lui succède comme chef de meute, et Benny, lui, souhaite simplement rester auprès de celui qui donne une raison d’être à sa vie, quitte à laisser Kathy sur le bord de la route.

Mais que l’on ne s’y trompe pas : The Bikeriders n’est pas l’énième errance d’un héros masculin désœuvré ayant troqué son cheval pour une moto. C’est avant tout un film sur le collectif. Nichols surprend à nous immerger au sein d’un groupe de parias soudés par la franchise et une passion commune. On y côtoie Zipco, Cal, Brucie, ou encore Funny Sonny, une ribambelle de motards un peu pathétiques mais désireux d’avancer ensemble, d’être ensemble. À bien des égards, le film réitère en vase clos la naissance et la chute d’une nation, éprouvant la capacité de ses membres à faire communauté jusqu’à un certain seuil critique. C’est une sorte de bulle utopique que Nichols nous fait miroiter avant de la mettre à mal à mesure que de nouveaux membres toujours plus séparatistes affluent dans les rangs des Vandals, désireux de modeler le groupe au gré de leurs fantasmes.


Critique du nouveau film de Quentin Dupieux
Quentin Dupieux est un réalisateur prolifique. À raison de deux films par an en moyenne, il tend à démocratiser un nouveau paradigme de production, avec des films moins longs et tournés sur une courte durée. Une méthode de travail qui permet au cinéaste de ne pas rester figé trop longtemps sur un projet, et d’ainsi diversifier sa proposition cinématographique. La recette Dupieux, c’est une expérience unique aux confins de l’absurde, le tout porté par un panel d’acteurs toujours plus étoffé. Et force est de constater que le cinéaste a le vent en poupe avec un succès qui ne cesse de croitre d’un film à l’autre. Voyons ce qu’il en est de son dernier projet, Le Deuxième Acte, projeté en avant-première pour l’ouverture du festival de Cannes 2024.
Le film introduit David et Willy, deux amis marchant vers un bar pour un rendez-vous hasardeux avec Florence, amoureuse de David, qui aimerait le présenter à son père Guillaume… Sauf que ce n’est pas de cela dont il va être question. Avant même d’avoir pu déclamer la moindre réplique, Guillaume se met en grève, ou plutôt son interprète, refusant de donner la réplique à sa fille supposée car selon lui, le script est nul. Ce refus de jouer va très vite se généraliser auprès des quatre protagonistes du film, tandis que le spectateur se retrouve propulsé de l’autre côté de la caméra.

Ce n’est pas la première fois que Dupieux nous fait part de son attrait pour les coulisses d’un tournage. À vrai dire, c’était déjà l’idée de son premier film, Nonfilm, où l’on suivait une équipe de tournage au service d’un réalisateur peu scrupuleux prêt à tuer ses équipiers pour obtenir le bon plan.
Si certaines similitudes sauteront aux yeux, Le Deuxième Acte met l’accent sur la dualité entre le comédien et son personnage, et comment la frontière entre les deux peut dérouter le spectateur. Les 4 personnages du film, jusque-là identifiables à leurs prénoms, perdent leur peu d’identité propre une fois leur rôle délaissé. Ainsi, on serait presque tenté de croire que Léa Seydoux, Louis Garrel, Vincent Lindon et Raphaël Quenard jouent là leur propre rôle, en toute conscience de cause.
En effet, si ce n’est pas le cas, Dupieux ne manque pas l’occasion pour jouer avec les stéréotypes véhiculés par le public autour de ses acteurs. Ces derniers en sont conscients et prennent un malin plaisir à s’attaquer les uns aux autres, désamorçant les préjugés tout en faisant rire. Mais Dupieux ne s’arrête pas là puisque de la bouche de ses acteurs se fait entendre un certain scepticisme à l’égard de l’industrie cinématographique, en prise avec de nombreuses affaires d’agressions sexuelles, mais aussi une vitrine où sous couvert d’autocensure, les acteurs vivent dans la peur permanente d’être cancel. Là où le cinéaste avait su rester assez évasif concernant ses opinions politiques dans ses films précédents, il va sans dire qu’il délivre là son film le plus engagé.

Fidèle à un certain dogme dupieusien, Le Deuxième Acte se distingue aussi par sa durée relativement courte, le tout s’achevant en un peu moins de 90 minutes. Mais cette économie de métrage se traduit aussi au sein du film, par son respect pour les unités de temps et de lieu, conventions usuelles du théâtre classique. Cette concomitance avec le théâtre est parfaitement assumée puisque le film peut aisément être découpé en trois actes. Le second, le plus consistant, débute à l’instant même où les protagonistes entrent dans le bar où se déroulera la plus grande partie du film. Bar intitulé Le deuxième acte, comme le film, donc.
Ce deuxième acte, justement, fait office de catalyseur. Là où le début du film respirait quelque peu par ses décors, le bar est quant à lui un décor de cinéma, si bien que tout ce qui s’y déroule est de l’ordre de la fiction. Le paradoxe étant qu’une fois à l’intérieur, aucun des comédiens ne veut jouer son rôle, à l’exception d’un malheureux figurant, qui s’avère être le propriétaire des lieux, incapable de servir un simple verre de vin à cause du trac. Lui qui avoue ne pas avoir dormi tant il était excité de jouer dans le film, devient l’objet de railleries tandis que les personnages de Quenard et Lindon l’observent échouer encore et encore. Difficile de ne pas voir le cynisme quant à la prétendue « magie du cinéma ».
Et puis, il y a le troisième acte. Malheureusement, en parler gâcherait la puissance esthétique du film, et rendrait caduque une bonne partie de cette analyse. Disons qu’il vient en quelque sorte rajouter une couche à l’ensemble, réactualisant tout le propos du film. Quentin Dupieux est un adepte de la mise en abyme et ce film ne fait pas exception, comme en atteste ce long travelling en fin de film, révélant son rail de guidage. Bien qu’il soit tentant de penser que le cinéaste s’est quelque peu radicalisé avec ce film, il conviendrait de ne pas faire une lecture trop hâtive d’une oeuvre qui, en apparence, semble un peu trop taillée pour faire réagir le public de la croisette. Chez Dupieux, le fond et la forme sont intimement liés, tout comme ce qui se trouve devant la caméra l’est à ce qui est derrière.
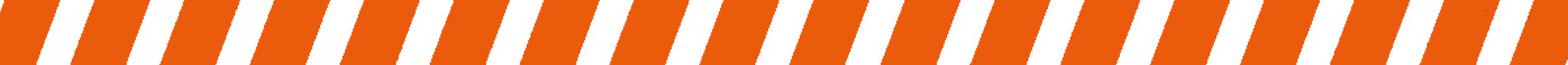
Critique de Vermines (2023) de Sébastien Vaniček
Au premier regard, Vermines s’inscrit dans une double dynamique : l’implantation d’un cinéma de genre francophone et la démarcation, au sein de ce dernier, d’une catégorie à laquelle appartiennent des œuvres s’ancrant au sein d’un territoire précis – les immeubles de banlieue. Aussi, si le film de Sébastien Vaniček succède aux récents Bowling Saturne, Ogre, Mastemah, Deep Fear, La Montagne, Gueules noires, ou encore Acide, il partage davantage de similitudes esthétiques et narratives avec La Tour. En effet, le film de Guillaume Nicloux met en scène différents groupes sociaux se retrouvant cloîtrés dans un HLM suite au surgissement d’un brouillard ténébreux venu encercler le bâtiment, annihilant quiconque ose s’en approcher. La teneur anxiogène d’un tel climat réveille, au fil des semaines passées enfermés, la nature profonde des individus et laisse progressivement place à une violence sans nom, annihilant de ce fait tout espoir d’entente entre les êtres. Dans Vermines, Kaleb, un jeune homme ayant récemment perdu sa mère, vit avec sa sœur dans l’appartement où ils ont grandi. Passionné d’insectes, il ramène un jour une araignée qu’il enferme dans une boîte à chaussures, sans se douter que celle-ci va s’en échapper et commencer à pondre là où elle peut, engendrant des centaines d’individus qui vont progressivement envahir le bâtiment et ses recoins les plus insoupçonnés.
Toutefois, s’arrêter à une telle catégorisation - Vermines ne serait qu’un nouveau film de genre contemporain ayant pour cadre un immeuble - serait réduire le geste de création de Sébastien Vaniček . Car, en donnant vie à de telles créatures, des araignées ne cessant d’en engendrer de plus dangereuses, s’adaptant à leur environnement et à l’agressivité de l’être humain, le réalisateur inscrit son film dans une double généalogie. La première concerne ce que nous pourrions appeler l’horreur naturelle, des Oiseaux (Alfred Hitchcock, 1963) à Razorback (Russel Mulcahy, 1984) en passant par Phase IV (Saul Bass, 1974), Les Dents de la mer (Steven Spielberg, 1975) et Piranhas (Joe Dante, 1978), tandis que la seconde témoignerait d'une forme d’épouvante claustrophobique liée à une présence malveillante – l’invasion arachnide finissant par pousser les autorités à mettre l’immeuble en quarantaine, les personnages se retrouvent assaillis, soit par les araignées ou les policiers. Alors, nous sommes évidemment, dans un tel contexte, proches de certaines œuvres de John Carpenter (Assaut, The Thing), de l’Alien de Ridley Scott ou encore du plus récent [REC] de Paco Plaza et Jaume Balaguero.

Alors, le territoire horrifique filmé par Vaniček se déploie d’un parking situé dans le sous-sol de l’immeuble jusqu’aux appartements des derniers étages, en passant par un couloir donnant accès à de nombreuses caves, des cages d’escaliers et des zones souvent mal éclairées – autant de hors champs potentiellement habités par les araignées. D’ailleurs, ces dernières se déplacent moins dans les artères citées précédemment, empruntées par les humains, qu’au sein d’espaces en marge : à l’intérieur des murs, entre les cloisons, là où sont tirés les câbles électriques, mais aussi par les bouches d’aération, pouvant ainsi pénétrer dans les appartements même si les portes sont verrouillées et condamnées par les locataires. C’est d’une telle dichotomie qu’émerge la singularité, avant tout esthétique, à l’œuvre dans Vermines : aux mouvements verticaux et horizontaux des êtres humains, inhérents au territoire qu’ils habitent, gravissant frénétiquement les escaliers ou courant à travers les couloirs, s’opposent ceux des araignées, bien plus aléatoires et imprévisibles. Si tension il y a dans le film de Sébastien Vaniček, elle émerge de la rencontre entre ces deux trajectoires, par essence antinomiques.
Mais la finalité, en tout cas narrative, de Vermines, concerne moins la rencontre que la reconnaissance. Dans une séquence de la première partie du film, les amis de Kaleb tentent de tuer une araignée dans une salle de bain, alors que l’animal n’a fait preuve d’aucune agressivité. En somme, on ne supporte pas la vue des araignées, donc on les écrase. Et finalement, au moment de quitter l’immeuble, alors que Kaleb fait face à l’une des créatures, énorme, celle-ci finit par se désintéresser de lui car il ne fait preuve d’aucune agressivité à son égard. Aussi, il semblerait que le propos du film soit d’envergure politique. Il s’agit, ni plus ni moins, de produire une oeuvre dont le discours sous-jacent concerne l’intolérance. Cette dernière se déploie alors autant à l’échelle d’un pays (les banlieues délaissées par le gouvernement) que dans l’intimité – Kaleb et Jordy, deux meilleurs amis d’enfance, ne parvenant plus à se supporter suite à un incident. Du macrocosme national au microcosme amical, toute forme de communauté semble menacée, telle est en tout cas la portée métaphorique de la créature de Sébastien Vaniček.
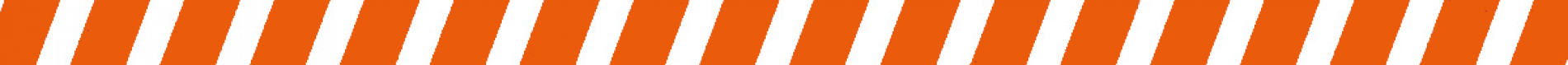
Critique du film Past Lives - Nos vies d'avant de Céline Song
Il est étonnant de constater que les deux séquences de séparation qui jalonnent le drame de Céline Song sont précédées de moments où la bande-sonore est toujours majoritairement habitée par des œuvres musicales intradiégétiques. Alors que Na-young, collégienne sud-coréenne sur le point d’émigrer en Amérique, discute avec ses parents du choix de son nouveau prénom (un plus occidental semblant s’imposer), le vinyle de Songs from Leonard Cohen joue le morceau « Hey, That’s No Way to Say Goodbye » - le père de la jeune fille finissant même par lui suggérer de s’appeler Leonora. Vingt-quatre années plus tard, Hae Sung, amour de jeunesse perdu et retrouvé de Nora, est assis au comptoir d’un bar new-yorkais au côté d’Arthur, le mari de cette dernière. Installée quelque part dans l’espace partiellement éclairé, une radio diffuse les notes à la tonalité mélancolique du « You Know More Than I Know » de John Cale.
Si, de toute évidence, les titres dont il est question viennent étayer l’ancrage de Nora au sein de nouveaux territoires – d’abord, le Canada de Leonard Cohen puis le New-York underground et intellectuel de John Cale -, il serait également possible de déceler dans leur citation l’expression d’une crise affective qui traverse le film. « Hey, That’s No Way to Say Goodbye » évoque avec tendresse un amour passé et la difficulté d’aller de l’avant après la séparation, tandis que dans « You Know More Than I Know » le narrateur finit par formuler une résignation face à un traumatisme : “Then bury me deep down among the weeds / That creep into the hearts of all the weak / And there’s nothing more so weak”. De l’émergence de la douleur à son acceptation, tel serait le programme narratif de Past Lives – Nos vies d’avant.

Une telle affirmation concernant le contenu du récit a de quoi décontenancer tant les grandes séquences du film se passent quasiment de dialogues. Si langage il y a dans le premier film de Céline Song, il est avant tout formel. Les citations musicales mentionnées précédemment cèdent toujours leur place à de grands moments de mise en scène. Rentrant à pieds du collège, Hae Sung et Na-young finissent par arriver à un croisement : un escalier sur la droite du cadre, une ruelle sur la gauche. Cadrés dans un plan large, les deux enfants se disent au revoir et empruntent chacun une direction différente. Un tel effet de mise en scène pourrait être dépositaire d’une certaine lourdeur - littéralement, nous l’aurons compris, leurs chemins se séparent – si Song n’avait fait le choix de refuser de couper le plan. Une dynamique formelle pour le moins ahurissante se déploie alors : les deux trajectoires empruntées et se dessinant à l’image sont indissociables de leur point de départ situé au centre du cadre – lequel devient aussi bien centripète que centrifuge en un seul mouvement. Un tel geste est dépositaire d’une promesse : cet écart entre les êtres pourrait de nouveau être comblé.
À la fin de la soirée qu’ils passent ensemble à New-York bien des années après, Nora décide d’accompagner Hae Sung jusqu’à son Uber. Un lent travelling latéral vient les cadrer alors qu’ils descendent une rue de l’East Village, se lançant de discrets regards empreints de pudeur. Arrive le moment où les corps se figent, placés au centre du champ, patientant jusqu’à l’arrivée du véhicule – deux minutes d’attente selon l’application. Une nouvelle fois, le plan ne coupe pas, et s’imprègne progressivement d’une tension quasi-insoutenable. Au centre du cadre, un écart entre les corps qui n’appelle qu’à se réduire – en somme, il s’agit de retrouver une proximité perdue, déchirée lors d’une sortie d’école vingt-quatre années auparavant. Réside, dans le primat que Céline Song accorde à la durée, dans ces plans évoqués comme dans bien d’autres du film (à l’image d’une pause sur les marches d’un parc en bordure du fleuve, à proximité d’un manège), toute la singularité d’une mise en scène hautement inspirée pour un premier film : si amour il y a, il ne peut se saisir, au sein d’un champ esthétique cinématographique, qu’à l’aune d’une séparation des corps. Alors, l’écart entre les êtres devient tangible, sensible, et révèle de ce fait sa teneur profondément tragique : c’est un gouffre.

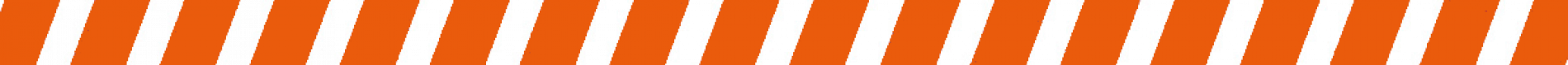
Critique du film Le Ciel rouge de Christian Petzold
« In my mind,
Love’s gonna make us, gonna make us blind,
We’ll be living in a place we like,
What’s gonna make us, gonna make us find ? »
Si le premier couplet de In my mind, morceau au rythme lancinant et résonnant au cours des premières secondes du Ciel rouge, installe un certain trouble en faisant rimer les termes « blind » et « find », il en va de même pour le générique du film qui défile dans le même temps. La typographie rappelle celle qui accompagnait les ouvertures des œuvres de la Nouvelle Vague tandis que la couleur des graphèmes, d’un rouge presque sanguin, évoque le souvenir de récits gothiques, soit un cinéma plus fantastique. Cette étonnante double généalogie s’incarne également au sein des premières images. Cadré dans un plan rapproché poitrine, la tête légèrement posée contre la vitre d’un siège passager, un jeune homme se réveille tandis que défilent sur le verre les feuillages d’innombrables arbres. Les quelques mots qu’il échange alors, à moitié hébété par la torpeur et la chaleur, avec son ami au volant révèlent leur situation : ils se dirigent vers la maison familiale du conducteur pour un séjour estival, loin de la ville et durant un temps encore indéterminé. Seulement, leur véhicule tombe en panne. Les deux jeunes se retrouvent seuls, avec leurs bagages en mains, au bord de la route, contraints de traverser les bois à pied afin de gagner la maison avant la tombée de la nuit.
L’ouverture du Ciel Rouge met en scène deux camarades à la dérive durant l’été. Le climat de torpeur installé par Christian Petzold convoque autant certaines chroniques rhomériennes (La collectionneuse, Conte d’été...) que des films estivaux européens plus récents, à l’image d’Eva en août (La virgen de agosto, Jonas Trueba, 2020), À l’abordage (Guillaume Brac, 2021) et I Comete (Pascal Tagnati, 2022). Dans le même temps, il est difficile de ne pas voir le spectre de films appartenant au genre américain qu’est le slasher, lequel n’a eu de cesse de mettre en scène des groupes de jeunes dans des territoires en dehors des grandes villes durant la saison chaude - moments d’évasion rapidement incisés par l’immersion de figures sanguinaires bien connues, de La dernière maison sur la gauche (The Last House on the Left, Wes Craven, 1972) à Souviens-toi…l’été dernier (I know What You Did Last Summer, Kevin Williamson, 1998). De la Nouvelle Vague au cinéma de genre américain, empruntant sans cesse aux clichés de diverses modernités esthétiques, le cinéma de Christian Petzold semble toujours se situer entre deux états, à l’image de Leon (Thomas Schubert) dans le premier plan du film – émergeant d’un profond sommeil, pas encore totalement éveillé.
L’œuvre du cinéaste allemand s’est distinguée, au cours de la dernière décennie, par sa capacité à faire cohabiter des héritages esthétiques en installant une inquiétude dans la mise en scène. Dans Ondine (Undine, 2020) entraient en résonnance un mythe germanique, l’histoire de Berlin et une passion amoureuse, les différentes nappes se succédant et finissant par se confondre dans une merveilleuse spirale sentimentale. Transit (2018), quant à lui, mettait brillamment en scène un jeune homme dans les rues de Marseille, où il rencontrait une femme avant qu’elle ne disparaisse. Un voile s’installait alors entre le personnage, les espaces qu’il arpentait, le temps passé et les personnes rencontrées – un héritage hitchcockien assumé. Une telle attention donnée à l’incertitude est loin de se limiter à l’ouverture de son dernier film. Tout Le Ciel rouge est construit à partir d’une idée simple que Christian Petzold va s’attacher à déplier : un jeune écrivain, Leon, se retrouve en vacances avec un groupe de jeunes et, en raison d’un profond égoïsme, passe en permanence à côté d’événements qu’il pourrait partager avec eux – en somme il s’agit, une fois n’est pas coutume, de décliner des formes de l’isolement.

Comme dans Transit, un voile s’installe entre le personnage et la réalité. D’abord, par une attention donnée aux mouvements. Leon insiste pour rester cloîtré, ne quitte pas la maison encerclée par les bois. Il fait de la tonnelle, située en marge de la demeure, à l’écart dans le jardin, un espace où il peut entretenir cette fixité, observant la bâtisse, les bois, les allées et venues de ses camarades – adoptant par conséquent une position de spectateur. Qui plus est, il ne participe jamais à la vie en communauté. Il ne s’occupe pas du linge, ne cuisine pas et refuse constamment de se rendre à la plage avec les autres. Contrairement à l’écrivain, Nadja (Paula Beer) quitte toujours la maison à vélo aux aurores (on apprendra plus tard qu’elle vend des glaces sur la plage, un job d’été qui va lui permettre de financer en partie sa thèse en littérature). Félix (Langston Uibel), le meilleur ami de Leon, ne cesse de faire des aller-retours à la plage où travaille Devid (Enno Trebs), un jeune sauveteur plein de fougue et d’une gentillesse à toute épreuve. Ces différentes trajectoires vont jusqu’à s’interchanger au sein même de la maison. Un soir, alors que Leon se réveille, il surprend Nadja à passer la nuit dans sa chambre, remplaçant Félix parti faire l’amour avec Devid dans celle d’à côté. À l’inertie de Leon s’opposent donc de nombreux mouvements sans cesse dessinés par ses camarades, si bien que le jeune homme a toujours un cran de retard sur les événements, n’arrivant pas à comprendre que son éditeur et ami est gravement malade, que Nadja est attirée par lui ou que Félix et Devid entretiennent une liaison.
C’est dans cette fixité d’un être que Christian Petzold poursuit l’une des idées de mise en scène de la première séquence de son film. Le réalisateur insuffle une tension qu’il est possible d’aller chercher du côté du cinéma de genre. Leon, prétextant rester à la maison pour travailler à son deuxième roman, n’arrive jamais à écrire. Il est en permanence en train de tourner en rond, s’amuse à jeter une balle de tennis contre un des murs de la maison et est de plus en plus exécrable avec ses camarades. Aussi, il fait indubitablement penser au Jack Torrance de Shining, œuvre dont de nombreux signes habitent étonnamment Le Ciel rouge. C’est donc autant chez Éric Rohmer que chez Stanley Kubrick qu’il faut situer l’héritage de l’art de Christian Petzold, à ceci près que la neige encerclant l’hôtel Overlook est ici remplacée par d’autres éléments naturels : la fournaise d’un côté, des incendies ravageant les forêts aux alentours, et la mer Baltique de l’autre. Les personnages sont coincés, errent entre les flammes qui se rapprochent et des algues biolumiscentes qui tapissent le fond de l’eau, illuminant la nuit tandis que le ciel rougeoie.
Comme dans Ondine, la crise morale du personnage principal se double d’une crise politique et historique, les spectres du mur de Berlin laissant leur place au désastre climatique. Un tel discours n’est jamais lourdement appuyé par Petzold durant la majeure partie du Ciel rouge. Le cinéaste aime d’abord considérer ces différents éléments comme de pures entités formelles. Le feu et l’eau délimitent un territoire, aussi bien géographique que mental, et leur colorimétrie vient progressivement contaminer les plans du film : de la robe rouge de Nadja aux raquettes illuminées de nuances de bleus utilisées en plein milieu de la nuit, le temps d’un dernier jeu entre amis avant le surgissement inéluctable de la catastrophe.


Critique du film Reprise en main de Gilles Perret
Une ascension ouvre le nouveau film de Gilles Perret : Cédric (Pierre Deladonchamps), prise en main, escalade un massif de Haute-Savoie sans assurance. Le danger guette l’individu à tous les instants, un plan finissant par le cadrer zénithalement, insistant de cette manière sur le vide qui guette sa silhouette. Aussi, à l’exhibition d’un exploit, le réalisateur préfère souligner les dangers accompagnant la performance.
La dynamique qui traverse l’ouverture de Reprise en main se transfère au sein de sa narration. Cédric apprend que l’entreprise dans laquelle il travaille va se faire racheter. Cette opération entraînant nécessairement de nombreux licenciements, il décide, en compagnie de ses deux meilleurs amis d’enfance, de monter un fond d’investissement dans l’espoir de récupérer la compagnie lors d’une vente aux enchères. Ainsi, se dessine progressivement une forme de rêve social : les salariés pourraient prendre le contrôle de l’entreprise, s’affranchissant alors des patrons. Cependant, cet autre désir d’ascension est également perturbée - rassembler la somme de 30 millions d’euros lorsqu’on est de simples salariés entraînant forcément des difficultés.
Émerge progressivement d’une telle écriture la singularité de Reprise en main : bien que les trois compères soient sans cesse freinés dans leur entreprise, ramenés à la réalité – Alain se fait licencier, tandis que la banque refuse à Denis de lui accorder un prêt -, ils ne cessent pourtant de rêver. Ainsi, comme les romantiques ayant également foulés ces territoires auxquels ils sont attachés (les vallées alpines et les sommets qui les bordent), Cédric et ses amis sont avant tout des rêveurs.
Cet aspect de l’écriture des personnages ne met en aucun cas de côté les problèmes sociaux soulevés initialement par le film. L’œuvre provoque un sincère sentiment de communauté grâce à des séquences mettant en scène des instants de partage : un dîner entre amis dans un jardin ou autour d’une fondue, des verres bus au pub du village, ou encore une soirée d’ivresse à la tonalité cassavetienne (cadres vacillants articulés à des gros plans sur des gestes ou un verre de vin qui se brise). Reprise en main témoigne ainsi du talent de Gilles Perret à enchevêtrer l’humour et un sentiment d’injustice sociale - la mise en scène de la communauté, chez le cinéaste, ne pouvant se passer de ces deux éléments.


Critique du film Sans filtre de Ruben Östlund
Difficile est la tâche de se confronter à l’oeuvre qu’est Sans filtre (Triangle of Sadness) sans préalablement avoir pris connaissance des retours assourdissants formulés à la suite de la projection et du sacre cannois : cinéma réactionnaire, film dégoûtant (pour ne pas dire dégueulasse), comique à destination des bourgeois - autant d’invectives finissant par faire échouer le film sur des rivages dont l’approche ne peut se faire sans une certaine méfiance. Alors, il n’y a qu’à lire les mots de Murielle Joudet, écrits dans les Inrockuptibles, accusant Ruben Östlund de dégainer “une redoutable machine à flatter son public, travestie en fable faussement subversive”, ou ceux de Yal Sadat, dans les Cahiers du Cinéma, reprochant au film son cynisme, sa rhétorique de comptoir et le didactisme ridicule de sa structure en trois actes (“une dissertation d’élève besogneux”), pour finalement se convaincre que, peut-être, la dernière palme d’or en date n’en vaut pas la peine. Pourtant, Sans filtre s’impose comme l’un des objets cinématographiques les plus intéressants de l’année 2022, totalement à rebours des autres films cannois qui étaient en compétition cette année.
Éventuellement faudrait-il, afin de saisir pleinement le sentiment de sidération qui nous saisit devant Sans filtre, ne retenir d’abord que deux séquences suffisant amplement à lever le voile sur les intentions esthético-politiques de Ruben Östlund : une grande bouffe et la course effrénée d’un jeune homme à travers les bois. La première est sans doute celle que la majorité des spectateurs n’oubliera pas. Intervenant au coeur du film, elle se présente, avant toute chose, comme un événement : les clients richissimes (vendeurs d’armes, propriétaire russe, instagrammeurs, mannequins et autres) d’une croisière s’effectuant à bord d’un yacht vont avoir l’honneur de participer à un dîner en présence du capitaine du navire. Cependant, l’épisode a lieu alors qu’une tempête se profile à l’extérieur et ne cesse de s’accroître, de dégénérer. Évidemment, cela influence l’état de certains clients : les corps sont d’abord penchés de façon ridicule lorsqu’ils se déplacent dans la pièce, Östlund installant ainsi une forme de burlesque que nous n’attendions pas nécessairement, et progressivement, les personnages se mettent à vomir, dans ce qu’ils trouvent (un chapeau, par exemple) ou sur les tables, voire dans leurs assiettes. Rapidement, la soirée dégénère, les clients finissent allongés dans les couloirs, du vomi au coin des lèvres et le teint blafard, les canalisations du navire s’engorgent à un point où les excréments finissent par remonter des différentes toilettes - alors, une eau marronâtre envahit les différents espaces du navire.
Il faut souligner à quel point Östlund n’est pas, contrairement à l’impression que pourrait laisser la description d’une telle séquence, dans la surenchère. Le cinéaste aime prendre son temps. Le vomi n’apparaît pas tout de suite et frontalement, il est d’abord présent à l’extérieur de la pièce, sur une vitre salie par un client sorti à l’extérieur. Certains sont en sueur, d’autres se lèvent et quittent la pièce. Les premières personnes concernées par les vomissements se trouvent d’abord à l’arrière-plan, floutées par la focale, ou alors ce ne sont que des sons habitant le hors champ. En bref, Östlund installe une situation et, petit à petit, la fait dérailler. Mais moins que l’articulation des différents moments qui composent cette séquence, c’est le discours qu’elle propose qu’il faudrait retenir : à des êtres vivants quotidiennement dans l’immatérialité la plus totale, le cinéaste oppose une matérialité quasiment triviale, frôlant souvent avec le biologique.
Ainsi, dans la deuxième séquence que nous retenons du film, Carl (Harris Dickinson) court à travers une forêt en hurlant. Des branches lui frappent le visage, l’écorchent. Il saigne, semble souffrir, mais court d’autant plus vite. Dans un moment vidé de toute substance narrative (nous savons où il se dirige mais ignorons totalement les raisons de sa course), Östlund confronte une nouvelle fois une matière à un corps initialement présenté, dans la séquence d’ouverture du film, où Carl auditionne pour un travail de mannequin, en tant qu’objet à inciter les clients de différentes marques à la consommation. En somme, une surface complètement lisse est progressivement détruite, à l’image, par une matière biologique. Aussi, Sans filtre s'illustre par sa manière de faire entrer en collision l’immatériel et le matériel, flirtant ainsi régulièrement du côté de Pier Paolo Pasolini et de ses 120 Journées de Sodome.


Critique du film Chronique d'une liaison passagère d'Emmanuel Mouret
Lorsque Charlotte (Sandrine Kiberlain) et Simon (Vincent Macaigne), amants passagers – de la nuit, comme du jour -,
se retrouvent un après-midi, ce n’est pas pour se lancer à nouveau dans les jeux de l’amour, comme chez Marivaux ou Rohmer, mais à l’occasion d’une projection de Scènes de la vie conjugale. Et Emmanuel Mouret, dans Chronique d’une liaison passagère, s’éloigne bien des récits aux teintes rohmériennes qui composaient son précédent film – le mémorable Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait (2020) – pour adopter une structure narrative plus bergmanienne. À ceci près qu’il s’agit désormais de filmer des scènes de la vie extra-conjugale.
Le titre – Chronique d’une liaison passagère – annonce déjà un certain programme. Charlotte, mère célibataire, et Simon, médecin marié et père de famille, entament une relation vouée à cesser un jour ou l’autre. Pour autant, ils décident rapidement d’écarter cette fatalité dans le but de profiter des moments qu’ils partageront. Ainsi, le film propose l’articulation de courtes séquences, précédées de cartons indiquant les dates et le temps qui s’écoule (« ça va vite », ne cesse de répéter Simon), au cours desquelles les amants se retrouvent.
Qu’ils soient dans un parc, au musée, dans un gymnase ou une chambre d’hôtel, Emmanuel Mouret ne s’intéresse jamais à la moralité qui induit leurs actes (Chronique d’une liaison passagère, à aucun moment, n'est un film sur l’adultère), mais souligne plutôt la dimension de partage qui ne cesse de surgir de ces instants. Alors, le commun ne naît pas seulement des relations charnelles, mais aussi de sourires échangés, ou alors de simples dialogues. D’ailleurs, ils n’hésitent pas à le clamer : ils aiment autant faire l’amour que discuter. Aussi, si la structure narrative de Chronique d’une liaison passagère emprunte à Scènes de la vie conjugale, la tonalité du film est à l’opposé de celle du cinéaste suédois.
Emmanuel Mouret s’inscrit plutôt dans l’héritage d’Ernst Lubitsch. Les appartements parisiens aux nombreux recoins, et plus tard l’immense maison d’architecte, ne sont pas nécessairement des espaces ramenant les personnages au sein d’un certain ancrage social – en bref, la bourgeoisie. Ils sont autant d’occasions d’ornementer la relation entre Charlotte et Simon. Chez Mouret, comme chez Lubitsch, le luxe et la coquetterie participent aux fondations d’un monde hors du nôtre, proprement cinématographique, où les émotions traversant les individus sont plus à même de surgir par le prisme de la mise en scène.
Lubitsch aimait recourir aux gros plans. Dans Le Ciel peut attendre (Heaven Can Wait, 1943), il les utilise afin de souligner les affects qui traversent le personnage interprété par Gene Tierney : par exemple, suite à un baiser volé par Henry dans la première partie du film. Mouret préfère de loin les travellings. Lorsque Simon, lancé dans un monologue, finit par dire à Charlotte, alors dos à lui et préparant à manger, qu’il ne faut pas qu’ils tombent amoureux, un lent travelling avant finit par cadrer la chevelure blonde de Sandrine Kiberlain en plan rapproché. Lors de cet instant quasiment hitchcockien, aucun mot n’est prononcé. Pourtant, tout est dit. Une fêlure a eu lieu, et nous en sommes les seuls témoins, presque à bout de souffle. Ce sont ces démonstrations passagères qui permettent à la chronique d’Emmanuel Mouret de s’envoler et de planer au-dessus de bon nombre d’autres films sortis cette année - un vol qui n’a cependant rien de surplombant, aussi léger et fragile que le sont Charlotte et Simon.

Mentions légales | Contact | Tel : 04.72.69.82.78